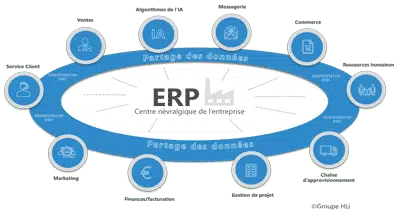Dans le domaine de l’assistance, pensez à bien distinguer les rôles de l’accompagnant et de l’accompagnateur. L’accompagnant, souvent lié à des contextes médicaux ou sociaux, offre un soutien moral et émotionnel à ceux qui en ont besoin. Il est présent pour écouter, conseiller et épauler les personnes en difficulté, sans forcément intervenir de manière active.
L’accompagnateur, quant à lui, se concentre davantage sur l’encadrement pratique. Que ce soit pour guider des groupes lors de voyages ou pour assister des personnes dans des activités spécifiques, son rôle est plus opérationnel. Il assure la logistique et veille au bon déroulement des événements.
Définition de l’accompagnant et de l’accompagnateur
L’accompagnant joue un rôle essentiel dans le soutien des individus, notamment dans le domaine éducatif et social. Par exemple, l’AESH (accompagnant d’élève en situation de handicap) intervient pour faciliter l’intégration scolaire des élèves handicapés. Il apporte un soutien personnalisé, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque élève, pour favoriser leur autonomie et leur participation en classe.
L’accompagnement est un phénomène social qui englobe diverses formes d’assistance et de soutien. Selon Maela Paul, docteure en sciences de l’éducation, la posture d’accompagnateur comprend cinq dimensions fondamentales : la disponibilité, l’écoute, la guidance, le soutien et l’encadrement. Ces dimensions sont essentielles pour créer une relation de confiance et favoriser l’apprentissage ou le développement personnel.
- Disponibilité : être présent et accessible pour l’accompagné.
- Écoute : prêter une attention active et bienveillante.
- Guidance : orienter tout en respectant l’autonomie de l’accompagné.
- Soutien : apporter un appui moral et émotionnel.
- Encadrement : structurer et organiser les activités.
D’autre part, l’accompagnateur, comme théorisé par Goffman, oscille entre engagement et distanciation. Il guide et encadre les activités pratiques, qu’il s’agisse de voyages, d’événements ou d’assistance logistique. Cette tension permanente entre implication personnelle et distance professionnelle caractérise son rôle, garantissant ainsi une intervention adaptée et efficace sans interférer dans la vie personnelle des accompagnés.
Rôles et responsabilités de l’accompagnant
Les AESH (accompagnants d’élèves en situation de handicap) ont pour mission de favoriser l’autonomie des élèves handicapés. Ils contribuent ainsi à la mise en place d’une école inclusive, visant à offrir une scolarité adaptée à chaque élève. Les AESH sont recrutés selon des critères de qualification professionnelle et bénéficient d’une formation initiale de 60 heures, complétée par des plans de formation proposés par les académies.
Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) sont des documents de référence pour les AESH. Le premier détaille les besoins spécifiques de l’élève et les modalités de son accompagnement, tandis que le second permet d’évaluer ces besoins de manière structurée.
Les PIAL (pôles inclusifs d’accompagnement localisé) optimisent les ressources humaines et matérielles pour une meilleure prise en charge des élèves. La CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) intervient pour valider les orientations et les dispositifs d’accompagnement.
La circulaire du 5 juin 2019 et le guide ressources humaines AESH – 2020 précisent les conditions d’exercice et le cadre d’emploi des AESH, assurant ainsi une cohérence dans l’accompagnement et une reconnaissance de leur rôle au sein du système éducatif.
Rôles et responsabilités de l’accompagnateur
L’accompagnateur, souvent perçu comme un guide, joue un rôle clé dans l’accompagnement social et éducatif. Selon Maela Paul, docteure en sciences de l’éducation, la posture d’accompagnement se décline en cinq dimensions essentielles. Ces dimensions incluent la relation d’aide, le soutien à l’apprentissage, la facilitation de la communication, l’encouragement à l’autonomie et la gestion des situations de crise.
Le concept d’accompagnement s’inscrit dans une approche holistique, où l’accompagnateur doit alterner entre engagement et distanciation, comme l’a théorisé Goffman. Cette tension permanente permet de maintenir un équilibre entre empathie et objectivité, garantissant un accompagnement efficace et respectueux des besoins de la personne accompagnée.
- Relation d’aide : L’accompagnateur offre un soutien moral et psychologique, facilitant l’expression des émotions et des besoins.
- Soutien à l’apprentissage : Il aide à acquérir de nouvelles compétences, en adaptant les méthodes pédagogiques aux capacités de l’accompagné.
- Facilitation de la communication : Il favorise les interactions sociales, en jouant un rôle de médiateur entre l’accompagné et son environnement.
- Encouragement à l’autonomie : L’accompagnateur stimule l’initiative personnelle et la prise de décision, dans une perspective de développement personnel.
- Gestion des situations de crise : Il intervient en cas de difficultés majeures, en proposant des solutions adaptées et en assurant un suivi régulier.
Le travail de l’accompagnateur exige des compétences variées, allant de la psychologie à la pédagogie, en passant par une connaissance approfondie des dynamiques sociales. La formation continue et la supervision professionnelle sont des éléments clés pour maintenir la qualité de l’accompagnement et répondre aux évolutions des besoins des personnes accompagnées.
Comparaison des deux termes et contextes d’utilisation
Dans le paysage éducatif et social, les termes « accompagnant » et « accompagnateur » sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils possèdent des nuances distinctes. L’accompagnant, tel qu’un AESH (accompagnant d’élève en situation de handicap), se concentre principalement sur l’aide directe et quotidienne aux personnes en situation de handicap. Leur mission consiste à favoriser l’autonomie de l’élève et à contribuer à une scolarité inclusive.
En revanche, l’accompagnateur, selon la définition de Maela Paul, docteure en sciences de l’éducation, incarne une posture plus globale et théorique. La posture d’accompagnateur inclut cinq dimensions : relation d’aide, soutien à l’apprentissage, facilitation de la communication, encouragement à l’autonomie et gestion des situations de crise. Cette approche multidimensionnelle, théorisée par des experts comme Goffman, implique une capacité à jongler entre engagement et distanciation.
Contextes d’utilisation
Les contextes d’utilisation des deux termes varient aussi. L’AESH est intégré dans le système éducatif et répond à un cadre réglementaire précis, tel que défini par des documents de référence comme le Projet personnalisé de scolarisation (PPS) et le Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco).
L’accompagnateur intervient dans des contextes plus divers, allant du travail social à l’accompagnement psychologique, et repose sur une dynamique relationnelle forte. Le cadre d’intervention est souvent moins formalisé, laissant place à une plus grande flexibilité méthodologique.